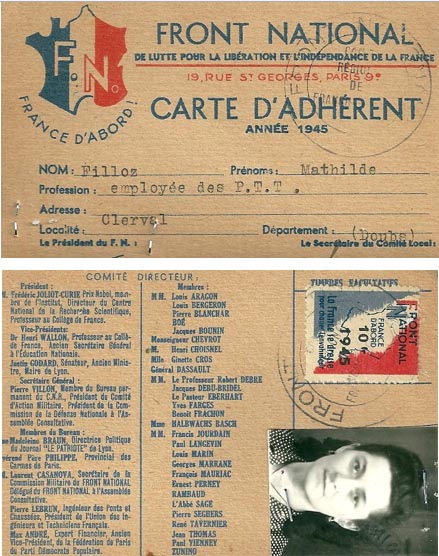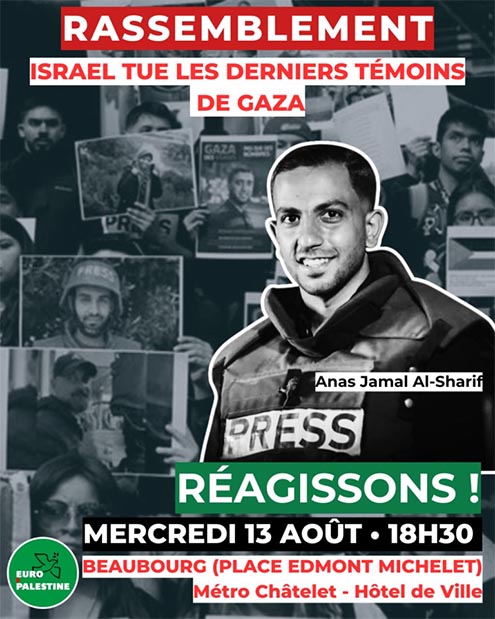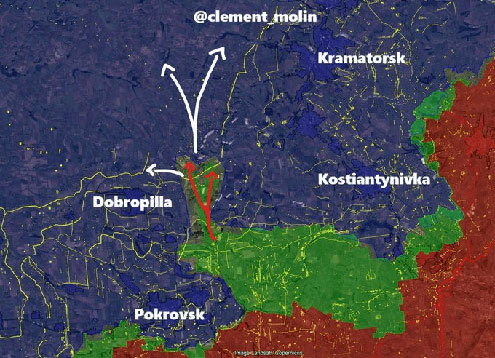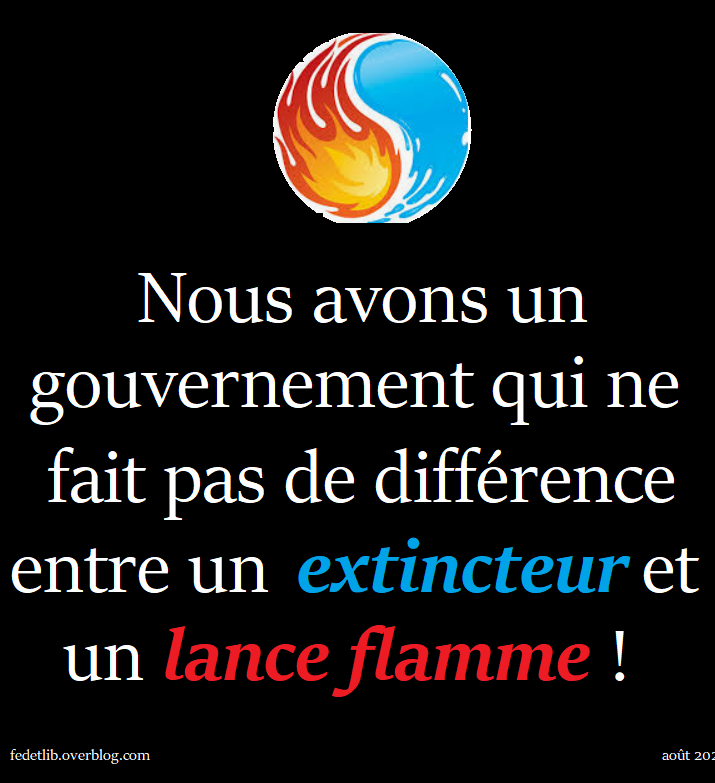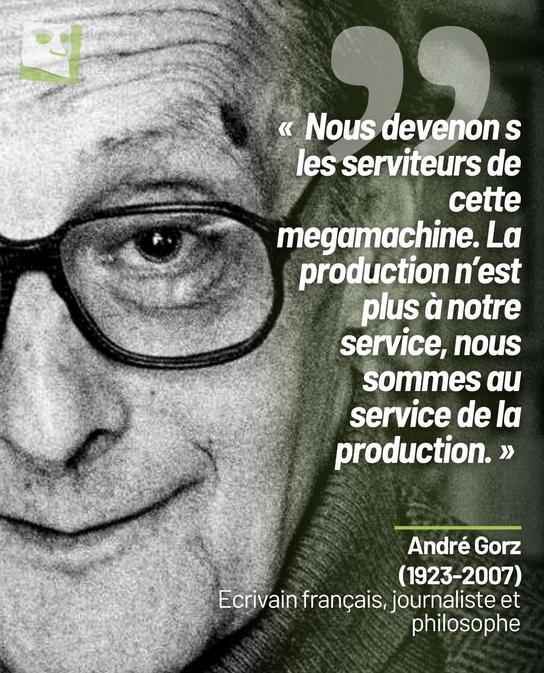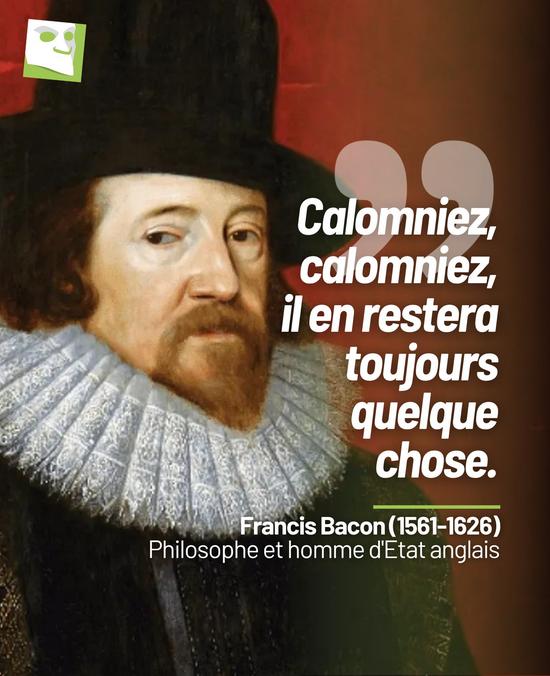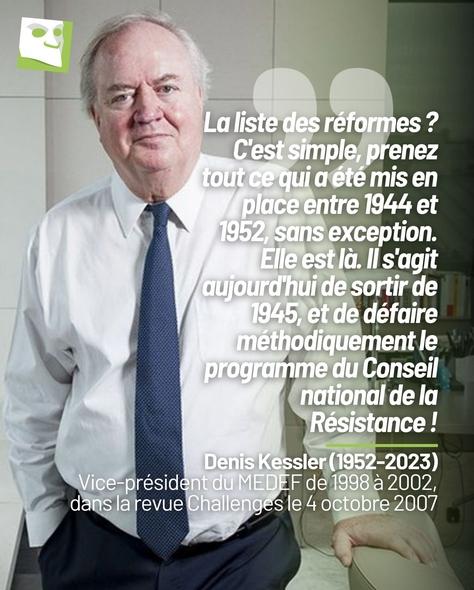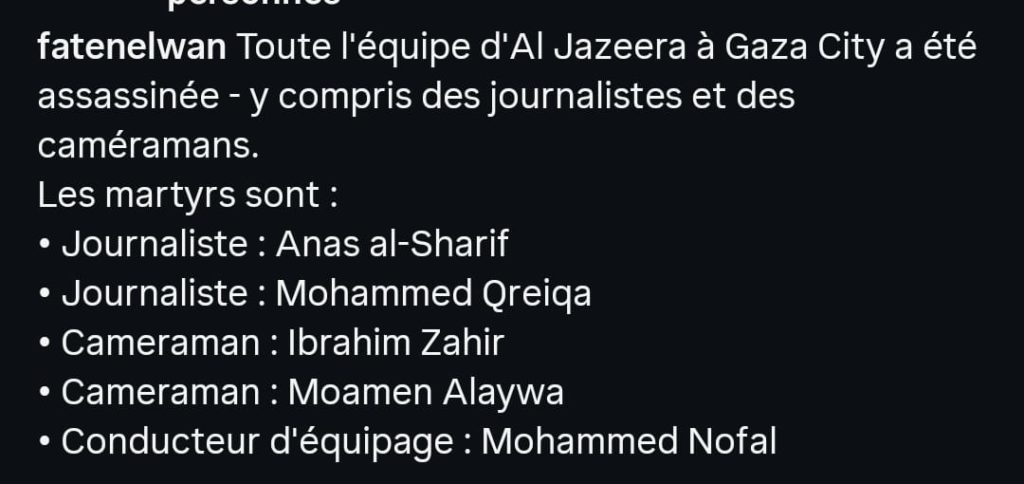Ce que l’on oublie trop souvent, en parlant du mythe de Pygmalion et de son impact symbolique, c’est que dans les Métamorphoses d’Ovide, l’histoire de Pygmalion suit immédiatement celles des Cérastes et des Propétides, dont elle est une sorte de suite inversée : les Propétides débauchées et prostituées représentent le volet féminin de la perversion sociale qui pousse le sculpteur Pygmalion vers la misogynie et un célibat conséquent dont il ne sort qu’en fantasmant à l’extrême sur sa propre créature féminine d’ivoire, qu’il nomme « Galatée », alors que Vénus venait tout juste de châtier les Propétides en les métamorphosant en statues de pierre.
Et donc c’est quasiment par antithèse, en récompense de la vertu d’un amour encore chaste, même si évidemment par nécessité, que Vénus donne finalement une vie charnelle à Galatée, la créature de Pygmalion.
Dans l’histoire sociale moderne, le mythe de Pygmalion devient le mythe d’une ascension sociale féminine propulsée par le désir masculin, à partir d’une personnalité féminine autrement vouée à une existence médiocre et quasi invisible en termes de rôle social et de notoriété.
Le cas inverse, fondé sur l’inversion des genres et des rôles, c’est-à-dire de la femme ayant autorité et propulsant sa propre créature masculine dans l’arène sociale, est, semble-t-il, assez rare.
Moins rares semblent être les cas se produisant dans les milieux de mœurs « intermédiaires », aujourd’hui couramment regroupés sous le label LGBT.
Donc, même et surtout si l’on exclut de le considérer dans cette catégorie, le cas des Macron-Trogneux reste un cas d’espèce, et en un sens, d’autant plus exceptionnel.
Mais c’est aussi et surtout un cas où Pygmalion n’a donc jamais lâché la bride à sa créature, depuis le jour de sa « création », comme épouvantail théâtral, et autrement.
Cliquer ici pour l’article et les commentaires